Introduction à l'économie
...et aux idées pour la comprendre
Ce site est le support à l'enseignement dispensé en L1 Économie à l'Université Paris Cité par Christophe DARMANGEAT. Il ne remplace en aucune manière le cours lui-même, ni la lecture attentive de certains ouvrages, dont ceux conseillés en bibliographie. Selon la formule consacrée, les propos qui y figurent n'engagent que la responsabilité de leur auteur.
La loi des débouchés
1. Quelques éléments historiques
Très tôt, l'économie
politique a été confrontée à un phénomène récurrent : celui des crises
économiques. Elle s'est donc interrogée sur leurs causes, comme sur les moyens d'y faire face.
Les crises économiques, au sens large, ne sont pas
nées avec la révolution industrielle et le capitalisme. Aussi loin
qu'on remonte dans l'histoire de l'humanité, les sociétés ont connu,
pour une raison ou pour une autre, des périodes de recul de la
production.
Avant la révolution industrielle, et aussi loin qu'on remonte dans le temps,
on peut dire que les crises économiques avaient
globalement une physionomie commune. Pour ne parler que de la période la moins éloignée,
celle de l'Ancien Régime, les crises étaient clairement causées
soit par des problèmes extérieurs à l'économie (guerres...), soit par une insuffisante domination de
l'homme sur la nature, qui le mettait à la merci des aléas
climatiques ou biologiques : climat trop rudes ou trop pluvieux
entraînant des mauvaises récoltes, maladies frappant le bétail, les
cultures... ou les paysans eux-mêmes, etc.
Dans tous les cas, les crises prenaient naissance dans le secteur de
la prodction agricole. Et quelles que soient les circonstances précises de
leur déclenchement, les effets de ces crises étaient globalement
toujours les mêmes : réduction de la production des moyens de
subsistance (en particulier la nourriture), et par conséquent,
hausse
vertigineuse des prix de ces subsistances. Ceci s'accompagnait parfois
de la mort d'une partie de la population paysanne, et donc de la
diminution des capacités de production de la société.
Avec la
révolution industrielle, l'essor de l'industrie et du commerce,
émerge peu à peu un nouveau type de crises. Pendant plusieurs
décennies, durant la première moitié du XIXe siècle,
les crises prendront une forme complexe, tenant à la fois
des crises d'Ancien Régime et des crises industrielles modernes ;
c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, durant toute une période,
les économistes s'interrogeront sur la nature de ces phénomènes
nouveaux. Ce n'est qu'à partir des années 1860 que les crises
prendront définitivement leur forme moderne, qui amènera à son tour
une nouvelle série d'interrogations afin d'en comprendre les origines
et les mécanismes.
Par bien des aspects, la physionomie des crises industrielles et commerciales
modernes est donc strictement inverse des
crises d'antan. La crise moderne ne survient pas, ou pas forcément,
suite à une catastrophe ou à une calamité naturelle. Surtout, là où la
crise se traduisait auparavant par l'insuffisance de la production de
subsistances, la crise moderne apparaît comme un trop-plein, un
excédent de marchandises ; alors que dans les économies précapitalistes,
il y a avait crise parce que la société n'avait pas été capable de produire suffisamment,
les crises capitalistes apparaissent comme le résultat d'un excès de production
— non un excès par rapport aux besoins absolus de la
population, mais par rapport aux capacités d'achat du marché.
Dans une crise précapitaliste, les biens sont introuvables ;
dans une crise industrielle, les marchandises
invendables s'entassent à présent dans les magasins et dans les
stocks. Alors que les anciennes crises entraînaient les prix à
la hausse (inflation), les crises modernes provoquent leur
baisse (déflation). Pour
résumer la chose en une formule, la crise précapitaliste était
typiquement une crise de sous-production par rapport aux besoins physiques
; la crise moderne est une crise de surproduction par rapport aux
besoins solvables.
Dès la première moitié du XIXe siècle,
les crises, au moins sur certains aspects, prirent de plus
en plus les caractéristiques des crses modernes. Les
économistes de cette époque ont donc cherché à comprendre si ces
à quoi étaient dus ces phénomènes nouveaux : étaient-ils liés, ou non,
à la nouvelle organisation économique ? Faisaient-ils partie du
fonctionnement-même du capitalisme, ou devait-on les attribuer à des causes
extérieures (exogènes) ?
2. L'impossibilité de la surproduction générale ?
Une problématique traverse tout le courant classique du début du XIXe siècle :
est-il concevable, comme certains épisodes semblaient l'indiquer, que l'économie soit en situation
de surproduction généralisée ? Quer l'ensemble des secteurs ait produit au-delà des capacités
d'absorption du marché, et que l'ensemble des marchandises soit ainsi invendables ? Une telle
situation, nouvelle à l'époque, paraissait si aberrante qu'elle fut largement atribuée à des causes
extra-économiques. Jean-Baptiste Say, suivi par David Ricardo, tentèrent de
démontrer l'impossibilité de la surproduction générale dans le cadre
du fonctionnement normal de l'économie de marché, un théorème connu sous le nom de
loi des débouchés. Seul, à l'époque, Malthus s'inscrivait en faux
contre cette affirmation. Le débat ne faisait que commencer...
Jean-Baptiste Say et la Loi des débouchés
Le plus célèbre économiste, sinon le premier, à avoir énoncé la célèbre
« Loi des débouchés », est le français Jean-Baptiste Say. Cette loi
des débouchés est souvent énoncée sous la forme concise, selon laquelle
« toute offre crée sa propre demande ». Cette pharse est toutefois un peu
trompeuse : elle laisse en effet entendre que Say excluerait toute possibilité de
surproduction soit possible, ce qui n'est pas le cas : il exclut la possibilité de surproductions
générales ; il y a là davantage qu'une nuance.
Say admet en effet tout à fait qu'il puisse
exister des surproductions partielles, et que par
exemple, on ait produit trop de chaussures. Mais pour lui, cela
signifie obligatoirement que parallèlement, il existe un autre secteur où il y a
sous-production : on aura par exemple pas assez produit de chemises.
Say admet donc qu'on ait employé trop de ressources ici, pas assez là.
En raison d'une mauvaise répartition des efforts de production, c'est-à-dire
d'une mauvaise allocation du capital. Mais ce qu'il rejette comme une absurdité, c'est l'idée
qu'on puisse avoir trop produit dans tous les secteurs à la fois
(rappelons que l'on ne parle ici que par rapport aux capacités
d'absorption du marché, et non par rapport aux besoins de la
population : en économie de marché, un besoin qui ne peut pas payer
n'existe pas).
Pour justifier cette affirmation, l'argumentation de Say est au fond, très simple.
Une première manière de l'exprimer est de dire qu'à un niveau
global, le montant d'argent disponible pour l'achat est par définition égal à celui qui résulte de la vente. Quel
que soit le niveau des prix, la somme des demandes (les achats) équilibre nécessairement la somme des offres (des ventes)
puisque l'achat et la vente sont un seul et même phénomène
considéré sous deux angles différents (comme les deux faces
de la même pièce). Ainsi, si l'ensemble des marchandises
produites s'écoule pour 100 millions d'euros, cela signifie que la vente de
ces marchandises va générer 100 millions d'euros de rentrées monétaires (quelle
que soit la manière dont ces rentrées se répartissent ensuite entre
les différentes catégories sociales). Et ces 100 millions d'argent sonnant et trébuchant sont
par définition excatement ce qu'il faut pour acheter les 100 millions de marchandises.
Qu'on remplace les 100 millions par 10 ou par 1000, cela ne change absolument rien à cette égalité,
qui reste vérifiée quoi qu'il arrive.
L'impossibilité de la surproduction
générale saute aux yeux, puisqu'à tout moment, la somme d'argent détenue par les
consommateurs est strictement égale à la valeur des marchandises qui
sont sur le marché. Tout au plus peut-on envisager que les goûts de
consommateurs ne coïncident pas avec les différentes quantités
produites, ce qui créera des déséquilibres sectoriels : les
chaudières resteront invendables — et leur prix baisseront — alors que les lunettes de soleil
s'arracheront à prix d'or. Mais, encore une fois, il est impossible
que toutes les marchandises soient invendables à la fois.
Si une telle situation devait se produire - et dès le début du XIXe
siècle, certaines crises présentaient déjà des traits de surproduction
générale — les causes ne pourraient en être recherchées qu'en-dehors
de l'économie, du côté d'événements politiques tels qu'une guerre, un
blocus, ou dans le fonctionnement contrarié du marché (monopoles, par exemple).
Pour Say, comme pour bien d'autres, dans son
fonctionnement normal et non perturbé, l'économie capitaliste était
incapable de provoquer de telles catastrophes.
L'argumentation de Say, telle qu'on l'a présentée ici, se ramène presque à une tautologie :
les achats équilibrent les ventes... parce que les ventes équilibrent les achats. En réalité, elle est un peu
plus profonde que cela, et repose sur une hypothèse centrale : celle que la monnaie ne sera jamais détenue
pour elle-même, mais uniquement afin d'acquérir immédiatement des biens. La conception de Say
repose donc sur la conviction que la monnaie est neutre : simple intermédiaire des échanges, elle
ne peut jouer un rôle actif (et donc, perturbateur) sur l'économie réelle. Elle ne peut pas être mise
(provisoirement) de côté, c'est-à-dire thésaurisée. Selon les propres formules de Say,
« la monnaie n'est qu'un voile » ; « les produits s'échangent contre des produits ».
La Loi des débouchés possède encore un autre corollaire. Elle revient en effet à affirmer
que l'épargne est par définition égale à l'investissement. Les produits fabriqués,
et vendus, se répartissent en deux grandes catégories : il y a des biens de consommations, destinés à être acquis
pour un usage direct, et des biens de production, qui correspondent à un investissement. Quant au revenu issu de la vente
de ces produits, il va lui aussi être affecté à deux usages possibles : une partie est consacrée à l'achat de
biens de consommation, l'autre qui est épargnée. Par définition, l'achat et la vente des biens de consommation
s'équilibrent, puisqu'il s'agit du même phénomène vu sous deux angles différents. La loi des débouchés revient
donc à affirmer l'égalité des deux autres postes, celui de l'épargne et celui de
l'investissement. En fait, dans l'esprit de Say, il s'agit plus que d'une égalité,
d'une véritabe identité : puisque la monnaie n'est qu'un voile, puisqu'elle ne peut en aucun cas être
détenue pour elle-même, tout se passe comme si, quoi qu'il arive, l'épargne se présentait directement sous
la forme de biens matériels d'investissement.
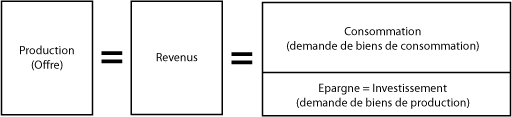
La reformulation par les néoclassiques
Quelques décennies plus tard, la loi de Say va être reformulée par le Courant marginaliste - école autrichienne.
Tout en réaffirmer sa validité, elui-ci va en effet affiner certains aspects du raisonnement.
Tout comme Say, les néoclassiques mettent en avant
le fait que le fonctionnement correct des marchés produit nécessairement un équilibre entre l'offre et de la demande.
Eux aussi nieront que la monnaie puisse être désirée pour
elle-même, et qu'il puisse exister des phénomènes de « fuite » monétaire (de thésarisation)
provoquant une situation de surproduction générale. Eux aussi
proclameront donc l'égalité nécessaire de l'épargne et de
l'investissement. Mais là où Say voyait en quelque sorte une
identité (l'épargne étant par définition un investissement, et les
deux phénomènes étant purement et simplement confondus), les
néoclassiques analyseront cette égalité comme le résultat d'un
processus de marché. Il reconnaissent ainsi l'existence de deux phénomènes distincts :
- une une offre de biens capitaux (l'épargne) de la part des consommateurs qui renoncent ainsi à une consommation actuelle, pour une consommation future (mais plus importante). une demande de biens capitaux (l'investissement) de la part des entrepreneurs qui désirent effectuer des production au meilleur coût.
Ainsi, si cette position s'éloigne de celle de Say sur certains aspects, elle conserve néanmoins
son hypothèse (et sa conclusion) fondamentales : la monnaie est neutre, transparente (l'épargne
se fait directement sous forme de biens de production), et ne peut donc déséquilibrer l'offre et la demande
globales, qui sont égales par définition.
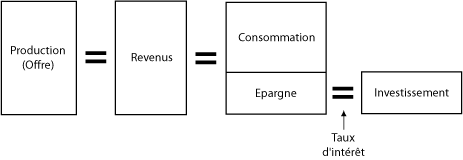
3. Les hétédorodoxes
Sur cette question, un point de vue opposé n'a cessé de s'exprimer, incarné par trois principales figures.
Thomas Malthus et l'insuffisance de la demande
Premier acte : le principal contradicteur de Say, du vivant
de celui-ci, est Malthus, ce qui illustre une fois encore l'hétérogénéité de ce qu'on appelle
parfois un peu hâtivement « les classiques ». Sur la loi des débouchés, en s'opposant à Malthus,
Say trouva un soutien indéfectible en la personne de D. Ricardo. Celui-ci se
situait pourtant aux antipodes de sa conception de la valeur... et reprenait par ailleurs
totalement à son compte la loi de la
population proposée par Malthus.
Contrairement
à Say ou à Ricardo, Malthus n'était nullement convaincu de l'impossibilité d'une surproduction générale.
L'argumentation de Malthus n'est pas toujours claire, ne serait-ce
que parce qu'il ne paraît pas avoir saisi dans cette affaire le rôle crucial de la monnaie.
Il insiste longuement, en revanche, sur la tendance des
capitalistes à freiner leur consommation et à augmenter leur épargne
(dans le but d'investir). Ceci, ajouté au fait que par
définition, les travailleurs ne perçoivent qu'une fraction de ce
qu'ils produisent, a donc selon lui tendance à déprimer la demande, et à
provoquer des situations où celle-ci ne parvient pas à absorber
l'offre. Pour illustrer son propos, Malthus imagine que les travailleurs improductifs (les
domestiques) soient brutalement employés à fabriquer des marchandises : celles-ci, venant s'ajouter
aux machandises existantes, seraient forcémement invendables, puisqu'en face, le pouvoir d'achat serait
resté le même.
On pourrait reprocher bien des faiblesses à cet argument ; toujours est-il qu'il
permettait à Malthus de souligner le rôle essentiel de la demande dans l'activité économique, et
en particulier de la demande de consommation improductive des propriétaires fonciers (la seule qui
permette vraiment de faire disparaître ce qu'on avait produit, et non, contrairement à la demande en
investissement, qui signifiait une production, donc des dificultés de vente, accrues dans le futur). Là où Smith
et Ricardo soulignaient le rôle de frein de la rente foncière, Malthus en faisait donc l'éloge — on remarquera
que l'argument de Malthus est une version savante, mais à peine différente du lieu commun selon lequel les pauvres doivent
remercier les riches de vivre dans le luxe, car c'est grâce à cela qu'ils ont du travail (faut-il préciser que cette manière de
présenter les choses est un non-sens, mais un non-sens qui arrange bien les riches en question ?)
Dès lors, les recommandations de Malthus sont d'une logique
impeccable : afin d'éviter de telles situations, il convient donc de
préserver, voire d'augmenter, les revenus des propriétaires fonciers.
Leur consommation improductive, en constituant un
moyen d'éviter la surproduction, est un gage de prospérité pour toute
la société.
Les développements de Malthus présentent au moins
autant de faiblesses que ceux de Say auxquels ils répondent. Car
ce que Malthus prétend implicitement, c'est que l'épargne des
capitalistes ne constitue pas une demande ; il ignore ainsi la
demande en biens de production, c'est-à-dire l'investissement.
Malthus commet donc finalement une erreur symétrique à celle de
Say : là où celui-ci pensait que toute l'épargne constituait par
définition de l'investissement, donc de la demande, Malthus
assimile l'épargne à une demande manquante.
Karl Marx et le rôle de la monnaie
Le renouvellement de
la discussion sur les crises de surproduction viendra en fait
d'une analyse plus précise du rôle de la monnaie. On associe très généralement cette analyse à Keynes.
Dans les années 1930, soit un siècle après Malthus, celui-ci a
en effet construit une théorie économique en partant explicitement
de la critique de la loi de Say et en rendant un hommage appuyé à
Malthus. Or, comme on le verra, cet hommage est en partie paradoxal,
du fait que les arguments de Keynes sont très éloignés de ceux de
Malthus. Mais Keynes a choisi de passer sous silence un autre critique de la loi de Say, dont les
arguments sont pourtant beaucoup plus proches des siens, à savoir
Marx. Je ne rentrerai pas ici dans la discussion sur les raisons du
peu d'estime dans lequel Keynes tenait l'œuvre de Marx.
Toujours est-il qu'une génération
après Say et Malthus, Marx, qui avait pu étudier les premières crises
capitalistes modernes, avait déjà longuement écrit sur cette question.
Pour résumer en quelques mots sa contribution, il suffira
de dire que celui-ci met au cœur de la question le rôle particulier
de la monnaie, marchandise particulière (équivalent général).
Marx affirme que la surproduction générale de
marchandises équivaut à une demande excédentaire de cette marchandise
particulière qu'est la monnaie ; les deux phénomènes ne sont qu'une seule et même chose
(selon qu'on la considère sous un angle ou sous un
autre). Marx insiste longuement sur cette possibilité des crises de
surproduction générale, qu'il estime
inscrite dans le fait même que la production capitaliste repose
entièrement sur l'achat et la vente de marchandises, donc sur la
monétarisation des produits (à la différence des autres
économistes, Marx considère cet état de choses comme une étape de
l'histoire humaine et nullement comme une donnée naturelle).
Autrement dit, le fait que tout s'achète et tout se vende permet
d'envisager la possibilité que pour des raisons diverses, et contrairement
à ce que pensait Say, la vente peut ne pas être suivie d'un achat ; les agents peuvent préférer
détenir de la monnaie que la reconvertir en biens matériels. Cette dissociation entre vente et achat
ouvre la possibilité de « fuites » dans le circuit, et d'un déséquilibre général entre
l'offre et la demande. Les capitalistes, en particulier, peuvent dans certaines situations
préférer thésauriser plutôt qu'investir, ce qui constitue une condition
suffisante pour entraîner une surproduction générale.
Marx, tout comme Malthus, critique donc la loi de Say, mais
d'un point de vue et avec des arguments radicalement différents. Il poursuit ensuite son analyse de deux manières :
- D'une part, en montrant qu'en économie capitaliste, la thésaurisation n'est que la forme la plus simple des perturbations liées à la monnaie. Les formes les plus complexes — et les plus fréquentes — sont celles liées à la création et à la destruction de monnaie par les opérations de crédit. Les variations de la masse monétaire liées au volume du crédit apparaissent donc comme l'élement-clé des crises générales, dans la mesure où aucun mécanisme n'assure l'adéquation stricte entre la masse monétaire en circulation et celle des marchandises à vendre
- d'autre part, en tentant de prouver qu'en économie capitaliste, les crises générales ne sont pas seulement possibles, mais qu'elles sont également nécessaires. Elles sont le produit inévitable du fonctionnement d'une économie fondée sur la propriété privée, la concurrence et la recherche du profit, où aucune autorité, aucun mécanisme, ne sont là pour assurer que la production s'accroîtra au rythme optimal. Bien qu'il n'ait jamais eu le temps de pésenter un exposé systématique, Marx a laissé de très nombreuses remarques éparses, qui une fois rassemblées, donnent de nombreuses indications sur les pistes qu'il convenait d'explorer selon lui. On discerne notamment les éléments d'une théorie du cycle, où les mêmes facteurs qui sont cause des phases de croissance entraînent les dépressions, et où sont impliqués tout à la fois les mouvements des prix, des salaires, les taux de profit, sans oublier bien entendu les taux d'intérêt et la masse monétaire, déjà mentionnée (pour ceux qui veulent aborder ce point de la pensée de Marx, je ne peux que recommander la lecture du livre de Marcel Rœlandts, l'un des enseignants en charge des TD de ce cours).
Pour Marx, le déclenchement régulier de crises générales est un symptôme du caractère aberrant et historiquement limité du
capitalisme. Marx ne se pose nullement le problème d'empêcher les crises — il ne croit d'ailleurs pas un instant que cela soit
possible — mais uniquement celui de montrer pourquoi le capitalisme doit être remplacé par une organisation économique différente, et
d'œuvrer à ce remplacement. Son analyse ne vise pas à fournir un guide pour permettre à l'État d'agir au sein du système, mais à
constituer un réquisitoire pour mettre fin à l'existence de celui-ci.
Keynes : la monnaie, et le taux de l'intérêt
Sur ce dernier point, Keynes se différencie profondément de Marx. Keynes n'est pas un révolutionnaire, tout au
contraire. Ce n'est même pas un réformiste, tout au moins si l'on entend ce terme dans le sens d'un « réformateur social », soucieux de
répartir les revenus avec plus d'équité, d'un avocat des salariés contre les riches.
Le problème de Keynes est précisément de sauver le système capitaliste que Marx voulait
renverser (et qu'à l'époque de Keynes, les héritiers politiques de Marx s'employaient à abattre). Keynes était convaincu que le discours néoclassique,
qui reprenait à son compte la loi de Say, était incapable de proposer une issue à la crise et au chômage de masse des années
1930. Or celleci faisait planer sur l'économie mondiale la menace de bouleversements sociaux qui pouvaient emporter le capitalisme
(en 1929, la Révolution Russe n'avait que douze ans).
Il est très significatif que dans sa critique de la loi de Say, Keynes ne fasse aucune référence à Marx
(avec lequel il partage pourtant certaines analyses) et qu'il se reconnaisse en revanche une dette vis-à-vis de Malthus, dont les
arguments sont pourtant très éloignés des siens. Le paradoxe n'est qu'apparent. Keynes, tout comme Malthus, et finalement comme
l'ensemble des classiques et des néoclassiques, s'inscrit dans le cadre de la société capitaliste, dont il se propose d'améliorer
le fonctionnement (quel que soit le contenu que l'on met derrière ces mots). Marx, lui, se pose en adversaire résolu de ce système
et surtout, il avait fondé et inspiré une série de mouvements politiques que les partisans du capitalisme étaient loin de
combattre uniquement avec des mots.
En élaborant sa théorie, Keynes ne s'adresse pas aux marxistes,
c'est-à-dire aux communistes, mais aux dirigeants économiques et politiques du monde capitaliste, afin de les convaincre qu'une
certaine action de l'Etat est indispensable pour redresser une situation catastrophique. Cette action de l'Etat avait d'ailleurs
largement commencé à prendre corps bien avant que les idées de Keynes soient publiées, et même formulées. Le problème, comme sa
solution, étaient dans l'air du temps.
Keynes, lui aussi, place donc au centre de sa critique de la Loi de Say le rôle de la monnaie. Il refuse en particulier
l'axiome de la neutralité de la monnaie, selon lequel elle ne serait qu'un simple voile dans une économie où les produits s'échangent fondamentalement
contre des produits. Il définit le capitalisme comme « une économie monétaire de production, », c'est-à-dire
« une économie où la variation des vues sur l’avenir peut influer sur le volume actuel de l’emploi ». Contrairement à
ce que pensaient les classiques et les néo-classiques, la monnaie joue donc un rôle actif. Elle constitue un levier dont l'État peut
s'emparer afin de modifier l'équilibre du marché, qui n'est pas forcément optimum.
Sa critique porte en particulier sur la théorie du taux d'intérêt des néo-classiques ;
Keynes refuse à la fois leurs analyses sur la manière dont il
est déterminé et sur son impact. Pour lui, le taux d'intérêt est une variable centrale,
qui établit le lien entre la sphère réelle et la sphère monétaire de l'économie. La critique (et les propositions théoriques) de Keynes
s'articulent en particulier autour des points suivants :
- l'épargne n'est pas un phénoème réel, mais monétaire. Elle ne prend pas la forme de biens de production, mais celle de monnaie ne servant pas à l'achat de biens de consommation.
- son niveau n'est pas déterminé par le taux de l'intérêt, mais par celui du revenu. Globalement, plus on gagne d'argent, plus on épargne une fraction importante de son revenu, quel que soit le taux d'intérêt.
- les détenteurs de monnaie arbitrent entre le fait de conserver leur argent sous une forme liquide (qui ne rapporte rien, mais qui est immédiatement utilisable en cas de besoin) et celui de le placer contre un intérêt. C'est là le versant monétaire du taux d'intérêt, qui apparaît non comme le prix de la renonciation à la consommation (chez les néo-classiques), mais comme celui de la renonciation à la liquidité.
- le taux d'intérêt, dans le même temps, possède un impact sur l'investissement (la relation de causalité est ici inversée par rapport aux néo-classiques). Plus le taux d'intérêt est élevé, moins l'investissement sera important, en raison des coûts des emprunts pour les enreprises.
À ce qui précède, on peut ajouter qu'en cas de fortes incertitudes sur l'avenir et/ou de menaces sur la rentabilité des investissements,
les détenteurs d'épargne auront tendance à conserver celle-ci sous forme liquide, exigeant un taux d'intérêt de plus en plus élevé pour s'en séparer. Ceci entraîne,
par deux voies symétriques, la dépression de l'activité : une partie de la monnaie, étant conservée, n'est plus convertie en achats et ne joue donc plus le rôle de
demande. Parallèlement, l'investissement est miné par la hausse du taux de l'intérêt.
Mais on peut également en conclure que l'État, qui maîtrise l'offre de monnaie, peut agir sur celle-ci, en faisant en sorte de l'augmenter.
Ceci, sous certaines conditions, peut contribuer à diminuer les taux d'intérêt, et à stimuler ainsi la demande, l'investissement, et par conrecoup l'emploi.
Là où Say mettait l'accent sur le rôle de l'offre, Keynes insiste quant à lui sur celui de la demande. Chez Keynes,
l'offre ne crée pas nécessairement sa propre demande ; celle-ci peut s'avérer insuffisante pour absorber l'offre.
À l'équilibre optimum, dont Say et les néoclassiques affirmaient qu'il était obtenu par les
seuls mécanismes du marché, Keynes montre l'existence d'un équilibre de sous-emploi, caractérisé par
l'existence d'un chômage involontaire.
Au laisser-faire et au libéralisme prôné par ses prédécesseurs, Keynes oppose la nécessité de l'intervention
économique de l'Etat.